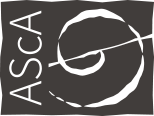Changement climatique et biodiversité agricole : faut-il choisir ?
Jusqu’à un passé relativement récent, que l’on peut situer au milieu des années 2000, les changements demandés à l’agriculture pour réduire ses impacts sur l’environnement — voire produire des aménités positives — allaient tous dans le sens d’une extensification des pratiques. L’extensification des systèmes de cultures et des systèmes d’élevage — avec la place centrale de la prairie permanente extensive comme garante d’une protection des eaux, d’un paysage de qualité et d’une richesse d’habitats — allait globalement dans le bon sens, du point de vue de l’environnement s’entend. Depuis une dizaine d’années, le changement climatique vient bouleverser cette convergence d’intérêts : d’une manière générale, l’élevage est pointé du doigt pour ses impacts directs — émission de méthane par les ruminants — et indirects — forte demande en grains et soja. Paradoxe majeur, l’élevage extensif devient l’activité la plus problématique : son efficacité, calculée en équivalent carbone par kg de viande ou de lait produit, serait moindre qu’un élevage intensif dont on peut mieux maîtriser les déjections, voire récupérer les émissions de méthane, le stockage de carbone par la prairie permanente ne compensant que partiellement les émissions.
Une équation climat apparaît alors imbattable : une forte régression — voire une disparition de principe — de l’élevage ruminant au profit d’une alimentation végétale, complétée par des viandes blanches (dont les animaux ne rotent pas), industrielle pour récupérer les déjections et les méthaniser. Les surfaces en prairies n’étant plus utiles, elles sont remplacées par des forêts qui soit stockent du carbone sur pied, soit sont source d’énergie renouvelable. C’est par exemple ce qui sous-tend la philosophie technique du scénario Afterres 2050 élaboré par Solagro, bien que sa forme soit moins radicale et ménage une part quelque peu ambivalente à l’élevage ruminant.
De fait, un front de débat se dessine entre les tenants de la maximisation climatique et ceux de la protection de la biodiversité via l’élevage extensif. Cette dernière cause était déjà difficile à défendre, elle devient inaudible, voire fait l’objet d’une critique radicale dans laquelle se combinent les procès en non reconnaissance de l’urgence climatique et en irresponsabilité alimentaire, avec les impacts des viandes rouges et des produits laitiers sur la santé. Les beaux paysages, les (petites) fleurs et les (petits) oiseaux deviennent un luxe qu’on ne peut plus se permettre. Le climat d’abord, on verra après pour le reste.
Il est certain que les prévisions récentes en matière de climat balayent les habitats — et les prairies sont parmi les plus sensibles à des variations de pluviométrie — et que les impacts climatiques sont systémiques. Les réfugiés climatiques, la faim dans le monde imposent une réduction urgente des émissions. Le dernier rapport du GIEC d’avril 2014 nous alerte sur le fait que nous sommes dans la dernière fenêtre temporelle pour corriger le tir, avant que le système climat ne dérape irréversiblement, avec des impacts qui emportent en effet la biodiversité et les habitats que nous connaissons encore. Après, il sera trop tard.
Il nous semble néanmoins que ce choix qui semble s’imposer entre climat et biodiversité est plus complexe que les constats évoqués ci-dessus le laissent entendre et, plus fondamentalement, mal posé. Trois grandes familles de contre-arguments peuvent être mis en avant, que nous proposons par ordre croissant de force.
En premier lieu, sur le plan de l’efficacité relative — ramenée en émission de gaz à effet de serre produit par kg de viande ou de lait — l’avantage de la production animale intensive sur la production extensive est souvent présenté comme une évidence validée par la Recherche. Mais quand on creuse la question, il apparait que cet avantage est ouvert à controverse et que de nombreuses publications, répondant aux règles de la publication scientifique, donnent des résultats contradictoires. Certes la production intensive produit davantage de viande/lait par animal — alors que la quantité de gaz issus de la rumination est globalement constante, voire supérieure pour des animaux qui métabolisent de l’herbe ou des ligneux — mais il faut aussi mettre dans l’équation l’intensification végétale qui accompagne cette production intensive depuis des décennies et qui consomme des engrais de synthèse également émetteurs de gaz à effet de serre, alors que la prairie permanente séquestre le carbone à long terme. Les changements d’usage des sols en Europe — remplacement de la prairie par des cultures — ou ailleurs — déforestation pour produire le soja qui reste la base de la production animale intensive — sont également à comptabiliser. Au total, les divergences entre publications contradictoires s’expliquent du fait des nombreuses incertitudes et des différentes échelles à considérer pour le calcul : à quelle échelle faut-il clore le système d’alimentation animale entre la prairie et le système de culture européens et le système brésilien ? Comment comptabiliser le fumier produit par les animaux, qui vient se substituer aux engrais de synthèse ? Comment comptabiliser la surfertilisation effective dans la plupart des systèmes d’élevage intensifs ? Quelle variabilité dans les relargages de gaz à effet de serre consécutifs aux changements d’usage des sols (labour d’une prairie ou d’une forêt) ? Combien les prairies stockent-elles de carbone ? Comment affecter les émissions aux différents co-produits qui sont nombreux tout au long de la chaîne, depuis le soja (huile, tourteaux) jusqu’à la production conjointe de lait et de viande ? Pour citer Jean-François Soussana (INRA), spécialiste reconnu sur ce point : « La vraie problématique réside dans le fait de réussir à communiquer de manière compréhensible sur ces incertitudes pour parvenir à mettre en place des politiques publiques et des actions privées dans le domaine de l’agriculture et du climat. Cela demande évidemment d’avoir la bonne information et de se laisser le temps de quantifier finement les enjeux pour préparer au mieux les actions à mettre en place. […] Par exemple, si [on] analyse deux types d’élevage – intensif et extensif – et regarde uniquement les émissions du territoire, alors ramenées aux émissions par unité de produit, l’élevage intensif est probablement moins émetteur. Mais les conséquences de l’importation de soja et les effets des changements d’affectation des sols (déforestation tropicale) ont été laissés de côté. En les prenant en compte, la comparaison des deux systèmes est certainement différente. » [1]. Ainsi, il apparaît précipité d’engager et de justifier une stratégie irréversible — le remplacement des surfaces en prairies soit par des cultures énergétiques, soit par boisements à vocation de production de biomasse — sur les bases des résultats d’une seule méthode de calcul.
Le deuxième ordre d’arguments considère les aspects socio-économiques et politiques des stratégies climat versus biodiversité. Même sous l’hypothèse que les formes d’élevage intensif soient plus efficaces sur le plan énergétique, cette efficacité est unitaire, calculée par kg de viande ou de lait produite. L’impact final de l’élevage dépend du volume total de production – en produits animaux – multiplié par l’efficacité unitaire de chaque animal. Or les pratiques garantissant une efficacité technique de l’élevage sont coûteuses : bâtiments pour confiner tous les animaux conduits sur un mode intensif (à comparer au pâturage), maîtrise et mécanisation de l’ensemble de la chaîne d’alimentation (apport aux animaux) et méthanisation dont les coûts sont élevés (près de 5 milliards d’euros de surcoût du tarif de l’électricité sont nécessaires en Allemagne pour que le biogaz soit rentable au niveau des exploitations). La couverture de ces coûts induit alors des stratégies de concentration et d’économies d’échelle conduisant à des unités de production plus grandes : la tendance sera alors l’augmentation de la production globale. Justifier le développement d’une filière animale intensive au détriment d’une filière extensive au nom du changement climatique bute alors sur les conditions de son efficacité d’ensemble, qui sont loin d’être acquises. L’argumentaire de l’intérêt écologique de l’intensification est de facto mobilisé par les filières animales intensives pour justifier leur développement – et non pas leur optimisation à effectifs constants, voire décroissants ! On conçoit que les marges de manœuvre techniques pour augmenter la production globale selon cette voie intensive soient élevées et annulent les gains d’efficacité individuels. A contrario, la défense relative de l’élevage extensif contre des formes intensives garantit un niveau de production global limité, voire réduit si l’on s’engageait dans la voie de l’extensification. Les raisons pour une telle défense sont nombreuses : qualité de l’eau et de l’air, paysages résilients, qualité sanitaire des produits (les antibiotiques sont nécessaires dans les élevages intensifs, et on les retrouve tout au long de la chaîne alimentaire), sans parler de leur qualité gustative et nutritionnelle. On peut ajouter à ces raisons le fait que l’élevage intensif — et son amont de productions végétales également intensives — coûtent cher au contribuable, par les aides publiques à l’agriculture et par les coûts de dépollution et de santé publique, sans compter sa faible efficacité en emplois, ramené au volume produit. La remise en cause de l’élevage intensif, sans se limiter au seul argument de principe de son efficacité climatique unitaire, serait alors une voie crédible pour réduire la production animale dans son ensemble et son cortège d’impacts négatifs (y compris sur le climat si l’on considère que l’usage d’engrais, climatiquement problématiques, est principalement justifié pour alimenter des filières animales industrielles).
Cet élargissement des considérants, dans une vision plus multifonctionnelle de l’agriculture, débouche sur la dernière série d’arguments. Une des justifications premières de la lutte contre le changement climatique est la préservation des habitats naturels, des écosystèmes et de notre cadre de vie ; tout un patrimoine naturel qui s’est constitué sur le temps long et qui s’accommode mal de changements brusques. Il serait alors paradoxal de les détruire sûrement à court terme au nom de leur protection de principe à long terme. Il y a plusieurs manières de ne pas relâcher de gaz à effet de serre dans l’atmosphère — à commencer par des économies dans les transports, le chauffage et l’industrie — alors que les usages du sol sont, eux, non substituables. Sans compter que ces habitats jouent également un rôle dans la prévention des risques climatiques par leur rôle tampon, brise-vent et anti-érosif ; ce sont ainsi des leviers essentiels pour l’adaptation aux risques climatiques à l’échelle des territoires. C’est un mauvais calcul de sacrifier des biens irremplaçables pour contribuer partiellement à un objectif qu’on peut atteindre par d’autres moyens.
Alors, pour revenir à la question posée dans le titre de ce papier : changement climatique ou biodiversité, faut-il choisir ? La réponse est oui : il faut choisir la biodiversité, et c’est sans doute la meilleure politique climatique que l’on puisse conduire.
Xavier Poux, AScA
[1] http://www.rac-f.org/IMG/pdf/AGRO-FICHES1-7-2.pdf, p 54